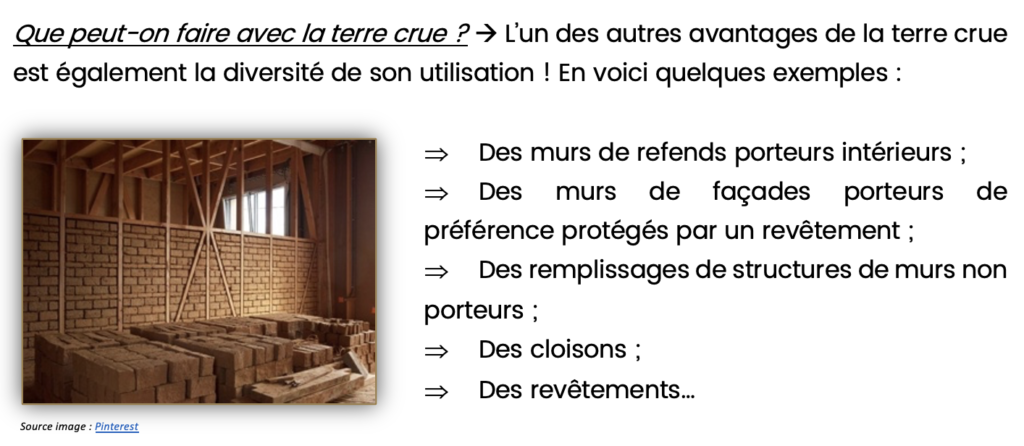Focus sur La brique de terre crue (BTC)
Pour bien comprendre les explications précédemment données, prenons l’exemple de la BTC. Ce dernier est une brique fabriquée à partir de terre crue fortement compressée. Un ajout de ciment est parfois réalisé afin de stabiliser la brique.
7 caractéristiques pour vous convaincre !
- Un matériau porteur : Étant une brique de terre compressée, la BTC est un matériau doté d’une résistance très performante (allant de 60 à 120 kg au cm2).
- Un parfait régulateur thermique et hygrométrique : Cette brique possède une très bonne inertie. En effet, son déphasage thermique (de 8 à 12 heures) permet le maintien d’une température stable et constante dans la maison ainsi qu’un taux d’humidité régulé.
- Un matériau sain et naturel : Une maison construite en terre est une maison qui garantit un confort optimal pour les habitants et réalisée d’une pratique durable et écoresponsable. Parfait pour l’avenir !
- Une solution écologique et recyclable : Comme énoncée ci-dessus, quelle que soit la phase (fabrication, mise en œuvre, etc), la BTC a la particularité d’être une très faible consommatrice d’énergie.
- Une parois régulatrice : Une brique de terre permet d’absorber le bruit, les ondes magnétiques ainsi que les odeurs.
- Un design à votre souhait : Le matériau a une richesse architecturale qui la différencie des autres matériaux. Quelles que soient les formes, les lignes, les textures, les lumières, etc… Personnalisez votre maison comme vous le souhaitez.
- Une taille optimale : La BTC peut avoir une taille de 9,5 cm x 14,5 cm x 30 cm et peser 8 kilos (en règle générale). Mais vous pouvez également retrouver des briques moins épaisses, ne dépassant pas les 5 cm.
Où utiliser la BTC ?
Fabriquer en brique de terre peut encore coûter cher car c’est un procédé qui n’a pas encore atteint sa maturité industrielle et peut impacter la durée des travaux. Pour ces raisons,certains acteurs privilégient des interventions sur certaines parties des ouvrages . Plusieurs options possibles :
- Dans les cloisons : Celle-ci pourra bénéficier des qualités d’isolation phonique du matériau (moins l’air passera, moins le son passera & moins la paroi « vibrera », moins le son se propagera).
- Autour de la source de chaleur : Poêles à bois, près des baies vitrés orientées vers le sud…
- Sous la forme de mur dit trombe ou capteur.
Pour développer la filières plusieurs dynamiques sont en cours.
1. Au niveau de la recherche.
Parmi les acteurs engagés dans la construction durable, la Confédération de la Terre Crue a un rôle central dans la promotion et la structuration de l’usage de ce matériau ancestral.
Elle rassemble :
- 5 associations régionales : l’ARPE Normandie, CTA en Bretagne, ARESO en Occitanie, TERA en Auvergne Rhône-Alpes et le Collectif francilien de la terre crue.
- 2 associations nationales : AsTerre et Maisons Paysannes de France.
- 3 fédérations syndicales : CAPEB, FFB UMGO et SCOP BTP.
La Confédération de la Terre Crue à pour missions de fédérer et représenter les professionnels, promouvoir et défendre la construction de la terre crue, ainsi que de soutenir et contribuer à des activités de recherche de la terre crue. L’objectif est de faire que la terre crue devienne une solution pérenne.
Pour atteindre cet objectif des initiatives ambitieuses et durables ont été réalisées :
- Le Projet National Terre (PNterre) : Labellisé par le Ministère de la Transition Écologique en 2021, ce projet vise à permettre le déploiement à grande échelle de la construction en terre crue.
- Guides de bonnes pratiques : édition, correction et traduction
- FDES : rédaction de fiches environnementales pour les techniques en adobe, bauge et terre allégée.
- SPG (Système Participatif de Garantie) : certification par les pairs sur chantier
- Reconnaissance UNESCO : démarche pour inscrire les techniques constructives au patrimoine immatériel
- CarAc’Terre : caractérisation des performances acoustiques des systèmes constructifs en terre crue, le projet est piloté par LASA – Ingénierie acoustique et vibratoire – leader reconnu depuis 1975 . le programme est financé par l’État dans le cadre du plan France 2030 et par l’Union européenne.
A noter également l’association CRAterre Home – CRAterre: Centre international de la construction terre qui œuvre à la reconnaissance du matériau terre afin de répondre aux défis liés à l’environnement, à la diversité culturelle et à la lutte contre la pauvreté.
2. Au niveau innovation
L’innovation dans le domaine de la terre crue ne se limite pas aux méthodes traditionnelles, elle s’étend aujourd’hui à des applications inédites, parfois là où on ne l’attendait pas. Un exemple frappant ? Le remplacement du bois par de la terre crue dans le coffrage du béton reposant sur l’impression 3D, une avancée majeure portée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Cette technique révolutionnaire, baptisée EarthWorks, exploite les ressources locales en transformant la terre en coffrage temporaire pour le béton qui ont l’avantage d’être entièrement recyclables.
A la différence des coffrages en bois, dont les formes sont rectilignes, l’impression 3D de terre permet une ouverture sur l’accessibilité de créer des formes architecturales innovantes et créatives sans avoir à dépenser plus d’énergie et de temps.
Cette innovation est un pas vers des perspectives de construction durable à grande échelle comme la construction de bâtiment entier en terre.
3. Au niveau des alternatives
Si la terre crue connaît un regain d’intérêt dans le secteur du bâtiment, elle se décline aujourd’hui sous différentes formes. Cela permet de répondre aux exigences contemporaines en matière de construction, parmi ces alternatives innovantes : le bloc de pisé compressé développé par Terrio se distingue par ses performances mécaniques et environnementales.
Contrairement au pisé traditionnel, qui est mis en œuvre directement sur site par compactage de couches successives, le bloc de pisé Terrio est préfabriqué, permettant ainsi :
- Une rapidité de pose.
- Un confort en terme d’inertie thermique, d’utiliser un matériau recyclable à 100% mais aussi réparable et réutilisable.
- Un impact carbone 6 à 20 kg du m2 (Selon ACV dynamique).
En résumé : la terre crue est une solution prometteuse pour une construction plus durable, à condition de bien maîtriser ses contraintes.